La valeur du désaccord
dans les études qualitatives
Débattre sans se battre : la solution Krisis et les projets Social Krisis
- Le recrutement, premier enjeu pour installer un désaccord constructif
- Une mise en scène originale, pour laisser place au désaccord, à l’argumentation et au changement d’opinion
- Une dramaturgie entre procès et confession, pour dépasser les préjugés et les mécanismes d’auto-censure
Bilan et conclusion
Débattre sans se battre : la solution Krisis et les projets Social Krisis
Krisis vient du grec κρίνω (krinein), qui signifie partager, discerner, distinguer et par extension juger, critiquer ou condamner. La crise, c’est le moment où tout se décide, le moment-charnière où la maladie peut guérir ou empirer, l’économie rebondir ou sombrer, où une relation peut repartir ou se rompre. C’est en tous cas un moment de tension extrême, qui révèle et amplifie les désaccords. C’est là qu’il faut chercher les solutions pertinentes aux problématiques du client, celles qui résultent de contradictions fortes et significatives. Cela nécessite une mise en scène précise et adaptée à chaque étape de l’étude, du recrutement à l’analyse et à la production de livrables.
Le recrutement, premier enjeu pour installer un désaccord constructif
Krisis n’est pas une méthode exploratoire. Pour lancer une telle étude, il faut déjà avoir une idée assez précise de la segmentation du marché, connaître ses lignes structurantes. L’opposition entre hommes et femmes, jeunes et vieux, ou utilisateurs et non-utilisateurs d’une marque n’aurait que les apparences du désaccord, puisque la segmentation sur des critères démographiques ou des comportements oriente le groupe à débattre dans les domaines affectif ou sensoriel. Le risque serait de retomber rapidement dans le cliché, les positions fermées sans souci d’argumenter, et de voir le débat dériver vers des sujets éloignés de l’objet d’étude. Aussi il est essentiel que l’opposition entre participants se fonde sur des attitudes, qui ouvrent à la possibilité de changer d’opinion. Un groupe Krisis sur le chocolat et la santé peut par exemple se composer de trois sous-groupes : ceux qui pensent que le chocolat est mauvais et essaient de limiter leur consommation, ceux qui pensent que le chocolat est mauvais mais n’essaient pas de limiter leur consommation, et ceux qui pensent que le chocolat est bon pour la santé.
La mise en scène très particulière de cette méthodologie innovante a toutefois l’avantage de permettre à des habitués des focus groups de participer, puisque les techniques d’animation diffèrent en grande partie des techniques classiques de groupes projectifs. La “viriginité” des participants n’est donc pas requise. Il faut en revanche qu’ils soient familiers de l’expression orale, afin de pouvoir argumenter clairement leur propos, et écouter avec courtoisie les autres participants. Cela requiert donc des capacités d’organisation de la pensée et de débat assez élevées.
Autre particularité du recrutement Krisis : le client participe au recrutement, puisque les sous-groupes doivent représenter un profil marketing déterminé, et s’opposer sur une attitude-clef. Dans le cas d’une entreprise de luxe qui voudrait approfondir son bilan d’image, il pourrait y avoir un sous-groupe adepte du luxe “bling-bling”, un sous-groupe “luxe BCBG”, et enfin des personnes ayant une très mauvaise image des produits du luxe.
Le désaccord repose donc sur des attitudes et non sur des comportements, ce qui permet de révéler le processus de décision ou d’achat, et ses différentes étapes. Les tensions qui en résultent concernent donc le produit ou service, plutôt que le participant. Il s’agit moins de comprendre qui est le consommateur comme dans certaines études exploratoires, que de déterminer son image du client, son rapport au produit, ce qui l’a mené à choisir ce service, et le processus qui distingue un consommateur convaincu d’un réfractaire, alors que leurs profils sont très proches. Ces attitudes se positionnent sur deux axes, l’un relatif au coeur de la problématique du client, l’autre à la problématique de l’étude. S’il s’agit par exemple de mesurer l’impact du discours sur les tests animaux dans l’achat de cosmétiques, il faudra organiser les sous-groupes en fonction d’un axe consommateur de cosmétiques / non-consommateur, et d’un axe sensible aux discours sur les tests animaux / indifférent. On pourrait alors recruter un sous-groupe d’utilisateurs de maquillage sensibles à la protection des animaux, un sous-groupe de non-utilisateurs sensibles aux discours sur les tests animaux, et enfin un sous-groupes d’utilisateurs indifférents à cette problématique.
Ce recrutement très précis nécessite donc plus de suivi que les recrutements classiques de groupes projectifs, et des participants “de meilleure qualité”, c’est-à-dire doués de bonnes qualités d’expression, de cohérence, de capacité à argumenter et à se confronter à d’autres. L’égalité entre chaque sous-groupe étant essentielle à la réussite de l’étude, il faut prévoir un sur-recrutement, ainsi qu’un casting quelques minutes avant la session afin de sélectionner les meilleurs candidats, et s’assurer qu’un camp ne sera pas dévalorisé par rapport aux autres.
Un déroulement original, pour laisser place au désaccord, à l’argumentation et au changement d’opinion
Idéalement, chaque sous-groupe Krisis se compose de trois personnes. Contrairement aux groupes projectifs à six ou huit, les participants doivent discuter entre eux plus qu’avec les animateurs. Il faut donc éviter d’instaurer une relation professeur-élèves, sachant-apprenant entre animateur et participants. Pour cela, les groupes Krisis font en général appel à deux animateurs, tous deux présents au début, puis qui se relaieront dans la salle par la suite. La scénographie se prête aussi au désaccord : plus de salle en U, où tous les regards convergent vers l’animateur qui pose les questions et mène la discussion, mais un cercle, qui reproduit les oppositions de l’hémicycle ou du tribunal, avec les animateurs assis parmi les participants. Il n’est pas nécessaire de se placer selon les sous-groupes, puisque dans cette mise en scène les participants peuvent se lever, changer de place et réorganiser la salle au gré de leur position. On peut ainsi mesurer visuellement l’impact de certains arguments et suivre les changements d’opinion.
Il faut éviter toute relation trop scolaire avec les animateurs, mais aussi avec les autres participants. Pour qu’une personne ne prenne pas trop d’ascendant sur les autres, le recrutement joue un rôle-clef, en ce qu’il doit permettre d’équilibrer les profils, d’avoir des participants doués des mêmes facultés d’expression et d’argumentation. Il faut aussi que les consignes soient partagées et comprises par tous : respect de la parole de chacun, désaccord sans conflit ni violence, volonté d’échanger des points de vue et d’écouter l’opinion de tous, possibilité de changer de camp selon la pertinence des arguments avancés.
Les animateurs se partagent la parole pendant l’introduction : il faut éviter que l’un d’entre eux n’apparaisse comme “le référent”. Ils annoncent aux participants que différentes postures seront représentées, et qu’il ne faut pas éviter de les confronter. Louis Rougier, qui a implémenté cette méthodologie à Ipsos France, suggère une introduction :
“Vous êtes là pour vous exprimer, dire absolument ce que vous voulez, que vous soyez d’accord ou pas avec les autres. On est en démocratie, certes, chacun est libre de penser ce qu’il veut, mais ici, c’est plus un débat qu’un échange de points de vue à l’amiable : vous serez donc invités à argumenter pour défendre vos positions, à convaincre. Si vous êtes très convaincu, vous pourrez tout faire pour convaincre les autres, les influencer”.
Contrairement aux groupes projectifs classiques où chaque participant se présente lui-même et a donc tendance à donner la meilleure image de soi, en groupe Krisis les participants se présentent les uns les autres, sans se connaître, ce qui a l’avantage de poser d’emblée une scène de désaccord et d’évacuer les préjugés fondés sur l’apparence et la posture physique. Plus précisément, en “présentation croisée”, chaque participant en décrit un autre comme s’il le connaissait, en lui inventant une carte d’identité avec prénom, âge, métier, quelques adjectifs, aussi bien positifs que négatifs, et son rapport au sujet d’étude. “Donnez à l’homme un masque et il montrera son vrai visage” : si elle peut entraîner du rejet au début, cette méthode de présentation a le double-avantage de créer un écran derrière lequel les participants pourront protéger leur intimité, à la manière d’un pseudonyme, et de les encourager à révéler leur véritable identité par leurs actes, leurs paroles, leurs arguments durant le groupe. Le prétexte de la fausse identité, inventée par un autre participant, favorise donc l’authenticité et l’implication, tout en évacuant dès le départ les tensions conflictuelles. De plus cet exercice est amusant, et crée plus de suspense qu’une présentation de soi par soi, ce qui encourage à écouter l’autre et à accepter ce qu’il pense, sans nécessairement y souscrire.
Pendant les quatre heures que dure le groupe, les animateurs, ou celui présent dans la salle, doivent se faire discrets, et surtout éviter de se mettre dans une position de supériorité face aux participants. Ils n’ont plus pour rôle de générer et d’encadrer la discussion, mais de la modérer, ce qui implique une relation d’égalité avec leurs interlocuteurs. La modération est un accompagnement pour éviter la violence et recadrer des discussions qui s’égarent, pas pour orienter le propos, ni surtout le diminuer. Le but est d’arriver à obtenir des opinions claires, tranchées, en franc désaccord les unes avec les autres ; contrairement aux groupes projectifs qui visent à découvrir un plus petit dénominateur commun de l’accord, un consensus a minima. Les animateurs ne demandent donc pas, ils proposent ; ils ne répètent pas, mais peuvent cautionner ou s’opposer à un argument pour stimuler le désaccord ; ils ne jugent pas mais accompagnent, aident les participants à s’exprimer et à s’impliquer.
Une dramaturgie entre procès et confession, pour dépasser les préjugés et les mécanismes d’auto-censure
Tout d’abord, après une radiographie classique où les participants sont invités à se positionner sur le sujet et à explorer l’univers qu’ils y associent, les animateurs disposent de différentes techniques d’animation destinées à susciter et alimenter le désaccord. Ces jeux de confrontation doivent alterner avec des périodes de débat, pour préparer les participants à défendre leur position et identifier celle des autres. Parmi ces techniques préparatoires on retrouve celle du jeu de rôle, qui consiste à prendre la place d’un produit pour décrire ses actions et sensations, à la première personne. Par exemple : “Moi, bouteille de nettoyant de la marque Cillit Bang, je vis dans un garage et ne sers qu’une fois tous les trois mois, pour nettoyer les taches de graisse et d’huile de moteur” (étude Krisis Cillit Bang, février 2007). Les autres participants peuvent alors réagir comme s’ils étaient vraiment face à l’objet d’étude, et lui exprimer, à la deuxième personne, leurs sentiments, d’affection, d’indifférence ou de rejet.
Prologue plus direct aux espaces de débat, les participants peuvent aussi se regrouper en triades en fonction de leur position vis-à-vis du sujet d’étude, et se défendre face aux deux autres triades, qui expliqueront à leur tour pourquoi ce sous-groupe a choisi une position opposée à la leur. Cet exercice s’applique aussi à l’échelle individuelle, avec un participant qui décrit, voire incarne, l’un de ses opposants.
Certains exercices sont aussi inspirés du débat parlementaire plus que du jeu de rôle. Les animateurs peuvent ainsi inviter les participants à rédiger une lettre d’amour ou d’injure au sujet d’étude. L’un d’eux est par exemple désigné pour écrire à Mc Donald’s, dans le cadre d’une étude Krisis sur son image de marque, tandis que les autres complètent son propos, le pondèrent ou l’orientent vers d’autres problématiques. Dans une argumentation plus directe, un orateur peut être choisi pour défendre son point de vue à l’oral, en un discours construit et engagé. De là un possible duel avec un autre orateur d’opinion contraire, chacun essayant de convaincre le plus grand nombre de personnes dans la salle.
Ces exercices alternent avec des moments de débat libre, durant lesquels l’animateur reste en retrait, même s’il arrive souvent que le client qui assiste au groupe soit mal à l’aise, décontenancé par l’absence de modération. A vrai dire la modération n’est pas tout-à-fait inexistante, puisqu’un animateur reste, aussi discrètement que possible, pour empêcher des coalitions entre triades ou l’élaboration de stratégies de persuasion. Dans les focus groups traditionnels il arrive souvent que des insights extrêmement révélateurs ressortent des moments de pause (entrée dans la salle, fin du groupe, absence du modérateur pendant quelques minutes pour chercher des produits ou gérer des urgences etc.). Dans la méthode Krisis ces moments sont valorisés : il est recommandé de les faire durer au moins dix minutes, une fois que les participants sont bien impliqués et connaissent bien les positions les uns des autres.
Le débat doit aussi être plus organisé afin de parcourir toutes les problématiques associées à l’objet d’étude. Pour cela, les Krisis font souvent appel à la dramaturgie du procès avec avocats, juges, victimes et condamnations, qui peut être séparée en deux temps : l’instruction et le jugement. Les rôles du plaignant, du juge, des avocats, des médias, des victimes sont distribués au hasard, sans égard à la position affichée par les participants. Les animateurs ne s’incluent pas dans le jeu, mais fixent les objectifs du débat, qui doit aboutir à répondre à quelques questions bien précises. L’instruction est l’occasion d’introduire de nouvelles “pièces à convictions” : packagings, publicités, slogans, benchmarks… Enfin le jugement doit être motivé, qu’il soit ou non accepté par tous les participants.
Ces différents exercices, qui alternent mises en situation, débats libres et débat organisé, visent à dépasser les préjugés, les mensonges et tricheries, souvent de bonne foi, qu’on fait pour se mettre en valeur ou pour protéger sa véritable identité, et l’auto-censure. Il s’agit de déstabiliser les participants pour qu’ils se dévoilent avec sincérité, authenticité et véhémence. La méthode Krisis demande donc de grandes capacités d’introspection et de prise de recul. Pour aider les participants dans cette voie, les animateur peuvent proposer à l’un d’entre eux, à n’importe quel moment du débat, de se prêter à l’exercice de l’isoloir : alors qu’un animateur reste dans la salle, le second va avec le participant dans une pièce à part, pour l’encourager à développer sa pensée loin du groupe, ou à donner son opinion sur les autres débatteurs. Parfois, cela peut aider à recentrer le débat en sortant un leader trop influent ou trop centré sur une seule problématique.
L’isoloir est le seul endroit où un participant pourra dire de sa voisine : “son argument était intéressant, mais on voit qu’elle est bien habillée, donc elle ne doit pas avoir de problèmes d’argent, elle juge de la chose en personne riche et habituée au luxe, ce n’est pas le cas de tout le monde”. C’est un enseignement très porteur d’insight sur le type projeté de consommateur d’un produit ou d’une marque, mais il n’est guère susceptible d’être exprimé en groupe projectif classique, ni dans la salle de groupe Krisis, car c’est un jugement ad hominem qui éloigne du débat principal, et qu’il porte sur l’argent, un sujet généralement assez tabou en France, entre participants qui se rencontrent là pour la première fois.

Bilan et conclusion
Dans l’animation Krisis, les attitudes sont dramatisées, c’est-à-dire mises en scène et intensifiées, ce qui permet d’obtenir des discours tranchés, authentiques, qui dépassent les barrières psychologiques des groupes projectifs classiques. Plutôt que de rationaliser leur comportement et de chercher des prétextes socialement valorisés à leurs choix, les participants sont incités à argumenter et expliciter leur attitude, à se défendre plutôt que se dédouaner. On obtient ainsi des éléments de langage plus vrais, plus impactants et plus riches en insights.
Cette méthode convient donc particulièrement bien aux études sur des sujets rupturistes ou polémiques, à l’anticipation et aux études prospectives, puisque Krisis radicalise les discours, ce qui permet de découvrir plus facilement les signaux faibles et tendances émergentes. Le participant n’y exprime plus souvent des idées et opinions, mais si le groupe est bien animé peut réveler des peurs, des désirs, des contradictions qui structurent intimement son rapport au produit, au service ou à la marque étudié.
Pour le client aussi, les groupes Krisis ont le grand bénéfice de découvrir directement des opinions cachées, politiquement incorrectes ou refoulées. Quand dans une étude sur la perception du luxe un participant s’exclame “le luxe, c’est la seule manière de profiter de soi tout en humiliant les autres !”, c’est un verbatim sincère qui ne nécessite pas d’analyse du discours. Si le désaccord naît bien souvent de la mauvaise foi, lorsqu’il est encadré par la méthode Krisis il encourage la sincérité, l’argumentation du parler-vrai plus que l’argumentation rhétorique, ce qui donne toute sa place au consomm’acteur, consommateur de plus en plus conscient de ses attitudes et de plus en plus critiques envers les discours publicitaires et marketing.
Pour ces raisons, Jean-Marc Lech n’hésite pas à qualifier la méthode Krisis de “fer de lance du quali” : elle met en valeur l’individu au sein du groupe, radicalise son attitude pour grossir les signaux faibles et intensifier la polémique, ce qui permet de dépasser les préjugés, les alibis, les rationalisations, l’auto-censure, et toutes les paravents que placent la politesse et les conventions sociales devant la réalité de notre rapport à un produit ou une marque.
Ce “fer de lance du quali” peut évidemment s’associer à des méthodes plus traditionnelles : celles des groupes projectifs, dont le rôle sera alors d’explorer un territoire ou une cible afin d’affiner le recrutement du groupe Krisis ; mais aussi celles des études quantitatives. Krisis servira alors, en aval, à déterminer la part de non-dit, qui ne peut pas apparaître dans une base de données quanti, ou en amont à concevoir des questionnaires basés sur les signaux faibles et tendances émergentes détectées, et formulés grâce aux éléments de langage impactants récoltés en débat.

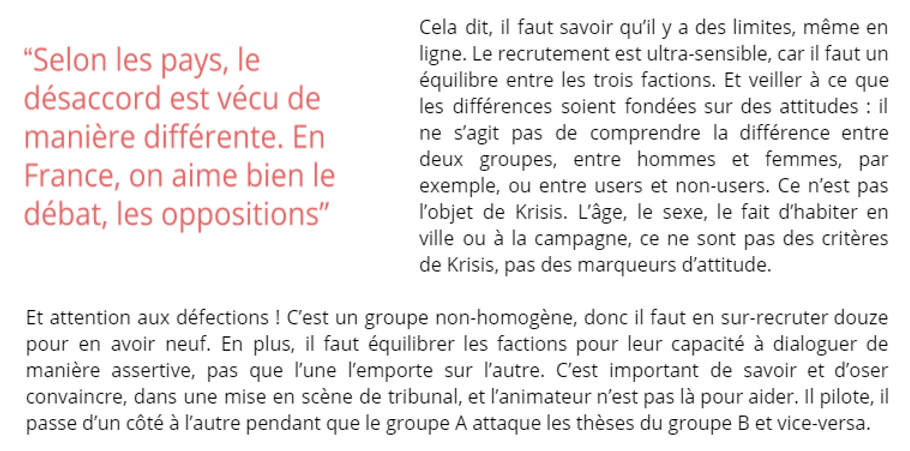
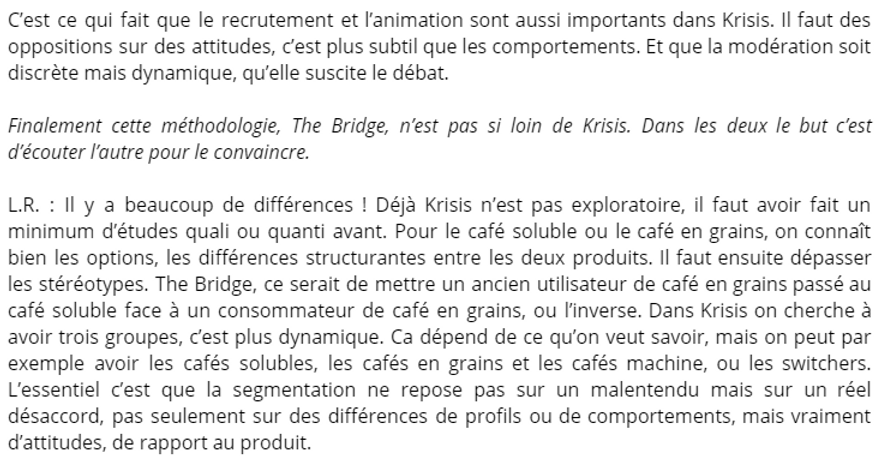



Par la mise en scène du désaccord à travers des exercices de débat, de duel, de jeux de rôle et de projections, articulés à des temps de pause et à la possibilité d’isoler un participant pour une “confession”, la méthode Krisis permet de révéler les attitudes d’un nouveau consommateur, désenchanté, plus méfiant envers les marques mais aussi plus familier du dévoilement de soi dans la télé-réalité, et du désaccord glorifié par les spectacles et loisirs, dans les médias et en politique. Cette méthode s’oppose au consensus, et cherche la vérité dans l’opposition, dans la sincérité d’une argumentation dramatisée plutôt que dans un plus petit dénominateur commun, le moins insatisfaisant pour la majorité. Cette argumentation dramatisée intensifie les tensions autour d’un produit ou d’une marque, pour grossir les tendances émergentes mais aussi pour révéler le consommateur à lui-même, l’aider à dépasser les stéréotypes, les rationalisations, l’auto-censure qui protègent son identité face aux autres, et lui construisent l’image qu’il estime la mieux socialement acceptable. Aussi cette méthode fonctionne particulièrement bien pour les sujets qui ont déjà été largement explorés et nécessitent d’aller plus loin que les stéréotypes classiques, pour les sujets polémiques, et pour les analyses prospectives et de tendances, sur des produits rupturistes ou des campagnes innovantes.
Plus dynamiques et plus en profondeur que les groupes projectifs classiques, et s’appuyant sur les conventions de dévoilement de soi de plus en plus présents sur les forums en ligne et dans la télé-réalité, les groupes Krisis pourraient donc être adaptés à des formats online. L’habitude des pseudonymes et de la “punchline”, du mot ou du tweet qui fait mouche, la facilité à se parler l’un l’autre directement plutôt que se référer à un animateur, répondent bien à l’objectif de dramatisation du désaccord promu par la méthode Krisis, et permettent l’évolution en direct du débat. Si la prise de position est moins visuelle, moins spatialement située, les changements d’opinion peuvent être rendus très identifiables par un système de couleurs par exemple, ou de hashtags, et être plus rapides. La mise à l’écart d’un participant, dans une discussion privée plutôt qu’un isoloir, est là aussi facilitée. Entretien avec Louis Rougier pour tester les avantages et inconvénients d’un développement online de la méthode Krisis.